Paul Ricoeur dies at 92
Though I didn’t follow his work that closely anymore, news of his passing immediately brings to mind London days in the early seventies, reading The Rule of Metaphor and the discussions that followed with Allen Fisher. Then in the eighties, long night talks in Paris with Douglas Oliver on Ricoeur’s volumes on narrative (as Doug was reformulating his poetcis toward encompassing narrative structures — rewriting The Pearl poem as The Infant and the Pearl.) Not sure that many American poets were strong readers of his work, but it would be interesting to find out.
Here is Le Monde’s obit for philosopher Paul Riceour:
Nécrologie
Paul Ricoeur, philosophe de tous les dialogues
LE MONDE | 21.05.05 | 13h56 • Mis à jour le 21.05.05 | 14h01
Le philosophe Paul Ricoeur, âgé de 92 ans, auteur de “Temps et récit”, est mort vendredi 20 mai, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Né à Valence (Drôme) le 27 février 1913 dans une famille de vieille tradition protestante, Paul Ricoeur perd ses parents alors qu’il est encore enfant. Pupille de la nation, il est élevé par ses grands-parents. C’est à son professeur de terminale, Roland Dalbiez (l’un des premiers, en France, à avoir écrit sur Freud), qu’il doit sa vocation philosophique. Devenu professeur à son tour après un travail de maîtrise sur “le problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau” et après avoir été reçu à l’agrégation de philosophie, il est mobilisé en 1939. Fait prisonnier en mai 1940, il passe l’essentiel de la guerre dans un oflag en Poméranie. Après la Libération, il est nommé à l’université de Strasbourg où il enseigne de 1948 à 1957 : dix années qui, ainsi qu’il l’écrira plus tard dans son autobiographie, Réflexion faite (Seuil, 1995), demeurent “les plus heureuses de (sa) vie universitaire”.
En 1957, il occupe la chaire de philosophie générale à la Sorbonne puis, en 1965, rejoint la toute jeune faculté des lettres de l’université de Nanterre, dont il devient doyen en 1969. Tout en faisant courageusement face à ses responsabilités administratives, Ricoeur, qui a déjà été choqué par Mai 68, vit assez mal les événements qui marquent les premiers mois de 1970 sur le campus de Nanterre, alors livré aux agissements de toutes sortes de factions violentes. Victime d’attaques injustes et même d’agressions physiques, déçu par l’incompréhension du gouvernement aussi bien que par l’impossibilité de moderniser les structures de l’enseignement supérieur français, il finit par démissionner de son poste de doyen (1970). Il s’exile alors pour trois ans à l’Université catholique de Louvain, avant de regagner Nanterre où il enseigne à nouveau jusqu’à sa retraite (1981).
Celle-ci lui permet de se consacrer plus intensément à sa seconde carrière, aux Etats-Unis, notamment à l’université de Chicago où, depuis le début des années 1970, il est invité chaque hiver. Il continue par ailleurs, jusqu’à la fin de sa vie, à consacrer une part importante de son temps à la Revue de métaphysique et de morale (qu’il a dirigée) ainsi qu’à l’Institut international de philosophie, et à recevoir de très nombreuses invitations émanant d’universités du monde entier (entre autres, plus de trente doctorats honoris causa).
Humaniste aux vastes connaissances, attentif à la littérature autant qu’aux sciences humaines (ainsi qu’en témoignent les textes réunis dans les trois volumes de Lectures publiés par le Seuil), voyageur ouvert à la culture anglo-saxonne aussi bien qu’à la tradition allemande, Paul Ricoeur est un homme difficile à enfermer dans une école ou un courant précis. Le christianisme, la phénoménologie, l’herméneutique, la psychanalyse, la linguistique et l’histoire ont, dans des proportions variables, contribué à la formation de sa pensée. Mais si celle-ci appartient, pour le dire vite, à la mouvance de l’existentialisme chrétien et du personnalisme, elle ne se laisse pas aisément réduire à un système.
Les premières influences qui s’exercent sur Ricoeur sont celles d’Emmanuel Mounier (1905-1950) et de Gabriel Marcel (1889-1973). Dès sa fondation par Mounier (1932), il devient un lecteur assidu de la revue Esprit, à laquelle il collaborera fréquemment après la guerre. Mais c’est d’abord chez Marcel que Ricoeur découvre le modèle d’une réflexion philosophique faisant une place centrale à la question religieuse sans pour autant renoncer à la rigueur conceptuelle. C’est grâce à Marcel, également, qu’il s’initie à partir de 1934 à la phénoménologie, en particulier à l’oeuvre d’Edmund Husserl dont il traduit pendant ses années de captivité le premier volume des Idées directrices pour une phénoménologie pure (Gallimard, 1950) et à celle de Karl Jaspers (1883-1969), auquel Ricoeur consacre son premier livre, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence (Seuil, 1947), écrit en collaboration avec Mikel Dufrenne.
Puis, pour obtenir son doctorat tout en donnant à ses inquiétudes de chrétien préoccupé par le thème de la faute une réponse digne des exigences de la méthode phénoménologique, Ricoeur entreprend une vaste Philosophie de la volonté dont le premier tome (Le Volontaire et l’Involontaire) paraît en 1949, les deux suivants (L’Homme faillible et La Symbolique du mal) étant ultérieurement réunis sous un titre unique, Finitude et culpabilité (Aubier, 1960).
Au fil de ces trois volumes, les questions classiques dont part Ricoeur (comment peut-on vouloir le mal ? Qu’est-ce que la mauvaise foi ? Quel est le sens d’un acte involontaire ?) l’amènent peu à peu à explorer, derrière la couche superficielle de la conscience, les profondeurs de l’inconscient individuel aussi bien que celles de l’univers symbolique dans les termes duquel les grandes religions s’efforcent de penser le problème du mal. C’est ainsi qu’il rencontre simultanément psychanalyse et herméneutique.
A l’époque, ces deux disciplines d’origine germanique sont mal connues en France. De Friedrich Schleiermacher (1768-1834) à Hans-Georg Gadamer (1900-2002) en passant par nombre de théologiens protestants, l’herméneutique s’efforce d’appliquer les outils de l’exégèse biblique aux contenus de la philosophie morale. La psychanalyse, par d’autres voies, remet en question le narcissisme du cogito classique. De l’une comme de l’autre, ainsi que des travaux de son ami Mircea Eliade, Ricoeur retient l’idée que la réalité humaine est avant tout constituée de symboles dont le déchiffrement est en droit interminable. Et c’est cette intuition qu’il développe dans ses deux livres suivants qui, sur le moment, ne sont pas toujours bien compris : De l’interprétation, essai sur Freud (Seuil, 1965) et Le Conflit des interprétations, essais d’herméneutique (Seuil, 1970).
Avec la question du symbolisme, Ricoeur (qui n’ignore pas l’enseignement de Lacan mais demeure étranger aux préoccupations antihumanistes du structuralisme) touche déjà le problème du langage. Il faudra cependant le poids d’une désillusion politique (liée aux obstacles rencontrés dans ses fonctions de doyen) pour que le philosophe, partiellement expatrié aux Etats-Unis, entreprenne de se consacrer plus à fond à l’étude des sciences linguistiques.
Progressivement accompli durant les années 1970, ce “tournant” lui permet d’être l’un des premiers Français à entamer le dialogue avec la philosophie analytique alors triomphante dans le monde anglo-saxon (notamment avec la “philosophie du langage ordinaire” inaugurée par John L. Austin et poursuivie par John R. Searle). Il débouche aussi sur deux ouvrages importants : La Métaphore vive (Seuil, 1975) et Temps et récit (trois volumes, Seuil, 1983-1985). Si le premier de ces deux travaux envisage la métaphore sous l’angle de la création de sens et de l’enrichissement qui en résulte pour le texte littéraire, Temps et récit, en rev
anche, dépasse de loin l’analyse linguistique. Au-delà de la réflexion sur l’écriture du passé qui s’y déploie, c’est la question même de la connaissance historique, de son statut et son apport de vérité qui s’y trouve posée.
Certes, un livre d’histoire relève toujours de la catégorie du récit, même lorsque son auteur entend – tel Fernand Braudel – pourfendre l’histoire événementielle pour lui substituer la “longue durée”. Mais ce récit n’est pas une forme narrative pareille aux autres. Au-delà de la”mise en intrigue” à laquelle s’exerce l’historien pour faire revivre le passé, c’est de notre réel qu’il nous parle. Le passé, en effet, ne nous appartient que dans la mesure où nous lui appartenons, où notre action présente s’inscrit dans la continuité d’une mémoire. Bref, dans la mesure où, pour les individus comme pour les peuples, l’identité n’est pas un donné mais une construction indéfinie, dont le temps est le seul médium possible.
Quelques années plus tard, Ricoeur s’attelle dans un livre difficile, Soi-même comme un autre (Seuil, 1990), à un effort héroïque pour sauver l’idée d’une philosophie universelle susceptible d’embrasser tous les aspects de l’agir humain. L’analyse – sémantique et pragmatique – de la notion de “sujet” et l’esquisse d’une ontologie de la “personne” (ou d’une “herméneutique du soi”) que propose ce travail se rejoignent en effet pour se mettre au service d’une éthique dont la formulation demeure, pour Ricoeur, une exigence de la raison pratique. Cette exigence, le philosophe doit s’efforcer de la satisfaire sans pour autant renoncer à son indépendance vis-à-vis de sa propre foi aussi bien que de toute idéologie théologique ou politique : tâche ardue, dont les difficultés sont bien mises en évidence dans les dernières études consacrées par Ricoeur à John Rawls (1921-2002) et à Hannah Arendt (1906-1975), et réunies sous le titre Le Juste (éditions Esprit, 1995).
Il apparaît ainsi que l’étude du langage, bien loin d’avoir été une fin en soi, n’a jamais constitué pour l’auteur de Temps et récit qu’une autre façon de poser les questions qui le hantaient depuis longtemps : celles de l’être et de l’action. Nostalgique d’une ontologie que Nietzsche semblait pourtant avoir disqualifiée, aspirant à trouver dans la raison éthique les règles de la vie”bonne” , homme constamment soucieux de son époque même s’il s’est toujours méfié de tous les engagements, Paul Ricoeur aura en somme incarné jusqu’à leurs extrêmes conséquences les déchirements qui sont ceux de la pensée humaniste depuis le début du XXe siècle.
Cette authenticité tragique, qui éclaire d’un bout à l’autre son long parcours intellectuel, fait aussi de son oeuvre un témoignage exemplaire sur la”crise” de notre modernité. Et sans doute est-ce sa valeur de “témoignage” q ui explique que cette oeuvre, après avoir été (comme celle de son ami Emmanuel Levinas) quelque peu méconnue par le monde intellectuel français, suscite depuis le milieu des années 1980 un regain d’intérêt particulièrement vif en France, et plus encore dans le reste du monde.
Christian Delacampagne
Article paru dans l’édition du 22.05.05

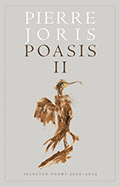 Poasis II: Selected Poems 2000-2024
Poasis II: Selected Poems 2000-2024 “Todesguge/Deathfugue”
“Todesguge/Deathfugue” “Interglacial Narrows (Poems 1915-2021)”
“Interglacial Narrows (Poems 1915-2021)” “Always the Many, Never the One: Conversations In-between, with Florent Toniello”
“Always the Many, Never the One: Conversations In-between, with Florent Toniello”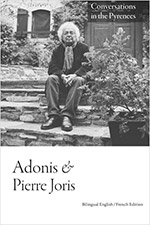 “Conversations in the Pyrenees”
“Conversations in the Pyrenees” “A Voice Full of Cities: The Collected Essays of Robert Kelly.” Edited by Pierre Joris & Peter Cockelbergh
“A Voice Full of Cities: The Collected Essays of Robert Kelly.” Edited by Pierre Joris & Peter Cockelbergh “An American Suite” (Poems) —Inpatient Press
“An American Suite” (Poems) —Inpatient Press “Arabia (not so) Deserta” : Essays on Maghrebi & Mashreqi Writing & Culture
“Arabia (not so) Deserta” : Essays on Maghrebi & Mashreqi Writing & Culture “Barzakh” (Poems 2000-2012)
“Barzakh” (Poems 2000-2012) “Fox-trails, -tales & -trots”
“Fox-trails, -tales & -trots”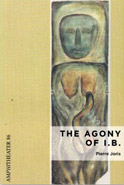 “The Agony of I.B.” — A play. Editions PHI & TNL 2016
“The Agony of I.B.” — A play. Editions PHI & TNL 2016 “The Book of U / Le livre des cormorans”
“The Book of U / Le livre des cormorans” “Memory Rose Into Threshold Speech: The Collected Earlier Poetry of Paul Celan”
“Memory Rose Into Threshold Speech: The Collected Earlier Poetry of Paul Celan” “Paul Celan, Microliths They Are, Little Stones”
“Paul Celan, Microliths They Are, Little Stones” “Paul Celan: Breathturn into Timestead-The Collected Later Poetry.” Translated & with commentary by Pierre Joris. Farrar, Straus & Giroux
“Paul Celan: Breathturn into Timestead-The Collected Later Poetry.” Translated & with commentary by Pierre Joris. Farrar, Straus & Giroux