On the same day — today — that
Philippe Lacoue-Labarthe was buried, his close friend and collaborator
Jean-Luc Nancy published an homage in the daily
Libération. Obviosuly there has not yet been time to translate it, so I will post the very moving good-bye to the philosopher “who was able to look madness in the eyes” in the original French — something Lacoue, who refused to have anything to do with the English language despite being a trained germanicist, would, I think, have appreciated.
Philippe Lacoue-Labarthe, la syncope reste ouverte
Par Jean-Luc NANCY
A toi, Philippe, pour te saluer. Pour te dire un adieu qui ne te promet aucun Dieu, puisque tu es parti vers rien ou vers toi-même, à moins que ce ne soit vers nous enfin tourné, retourné vers nous, forcément détourné des lointains vers lesquels tu ne t’en vas pas puisqu’ils ne sont pas. A toi qui es entré dans la seule présence pour toi douée de stabilité, dans la station et sur la stèle où tu déchiffrais l’immobilité dangereuse de ce qui se prétend identifié : la figure cernée, érigée. Entré dans l’inadmissible, disais-tu, de cette stance : l’étant transi, rien qu’étant, soustrait à l’infini d’être. Entré dans ce révoltant non-lieu d’être.
A toi qui as passé sur l’autre scène pour y jouer, retourné, le même rôle : l’impossible conformité au héros de soi-même, à ce héros que tout un chacun se doit d’accueillir en soi, comme soi, en place de soi, accueillant donc l’impossible.
A toi qui as accompli la seule révolution qui fût encore possible pour ton désir d’anarchie souveraine : celle de tes yeux révulsés, ne nous voyant plus et laissant couler des larmes. A toi qui as tenu l’engagement, le seul, auquel te vouait une force obscure, celui de retirer ton image dans ton ombre.
A toi qui voulais voir l’Ouvert, selon les mots de Hölderlin qu’il te fallait, pour cela même, réinventer. A toi qui ne voyais que clôtures et barrières, bornes intolérables, monde fini.
A toi qui voulais parler en maximes et en paroles, non pas en mots ni en propos. Des paroles lancées, proférées, adressées. Ces paroles dont l’héroïsme est la prononciation. Tu nommais cela «courage de la poésie». C’était encore une parole de ton héros, de ce héros presque sans figure ni stature, et retiré dans la tour de sa folie celui qui se signait pour finir du nom dansant de Scardanelli (1). Celui qui savait l’évidence du ciel au-dessus de nous.
La folie Philippe tu la regardais dans les yeux. Dans ses yeux égarés, tu regardais, tu scrutais l’approche de l’autre scène. Tu as toujours dit que tu devinais dans leur folie à tous (Rousseau, Hölderlin, Nerval, Nietzsche, Artaud) la subtile simulation de ceux qui parmi nous jouent l’autre scène. C’était ton paradoxe du comédien : plus il tient le vrai à distance, plus il côtoie la vérité, l’intraitable, l’innommable, la défigurée et défigurante.
Ainsi tu te composais le personnage de ta propre fable héroïque, l’acteur qui incarnait ce qui ne se peut représenter ni incorporer : la parole, en effet, non pas la formée et signifiante, mais la formante, l’incantatoire, la bégayante même. La poétique, oui, mais sans poésie, sans poïesis : non productrice d’ouvrages poétiques, mais mimétique seulement de l’inimitable balbutiement enfantin.
C’est l’enfant que tu désirais, l’enfant que tu semblais n’avoir jamais été. Tu jouais, en effet, si bien et si assidûment que tu avais déjà depuis longtemps eu l’âge de l’autorité et de l’expérience acquise. Tu avais toujours déjà l’âge que plus rien ne peut surprendre.
Cela me surprenait toujours à nouveau. Tu ne cessais d’étendre plus amont tes certitudes. Peut-être pensais-tu vraiment que tu savais ce qui est à savoir. Peut-être pensais-tu qu’en jouant ce rôle tu devais savoir, puisque ce qui est à savoir n’est rien d’autre que le jeu de la vérité : puisqu’elle n’est pas, puisqu’elle n’est rien d’étant, elle se joue vraiment elle est vraiment en jeu en se dérobant au coeur et au principe de toute représentation (de toute pensée, de tout art).
On ne passe pas derrière la représentation, tu y insistais farouchement, avec violence même, indigné qu’on puisse prétendre à une présence autre que la mort froide, innommable et inacceptable. C’est la représentation, c’est son jeu qui nous enseigne que la présence s’éloigne toujours plus loin, infiniment loin.
Ce que ta révolte permanente accusait, ce grondement fâché, c’était tout ce qui croit ou prétend croire à la présence. La figure, disais-tu, celle du pouvoir ou celle de l’art, celle de l’homme ou celle du Dieu infigurable. L’identité avérée, cernée, identifiée. Cela que tu pensais, non sans quelques raisons, menacer non seulement chez Heidegger mais en vérité dans toute pensée.
Ne rien figurer, ne rien se figurer. Tu écoutais la musique, celle qui ouvre des lointains et les garde lointains, les rapprochant de nous seulement pour aggraver leur distance irréparable. C’est ainsi que tu voyais l’ouvert : écoutant seul, fermé, voyant alors ou entendant s’ouvrir ce que tu nommais autre mot de H la césure. L’interruption, le suspens, la scansion, le silence, le blanc le négatif non pas en trou noir mais en rythme.
Le rythme, et par conséquent la phrase. Phrase, c’est ton titre, c’est ta parole, c’est ton souffle. La phrase : non le sens, non le but ni l’orientation, mais la sensibilité
de l’errance. La césure, la pause qui ouvre la cadence, la main du batteur levée loin de la caisse claire, l’archet soudain retenu sur la corde, la possibilité de la musique. C’est-à-dire du très peu de présentation qui nous échoit.
Un jour, il m’est venu d’user du mot de syncope, et tu l’aimais aussi. C’est par là, sans doute, que nous touchions le mieux l’un à l’autre et que nous fut donnée la possibilité d’un singulier partage des vies et des pensées. Entre nous, oui, un suspens, une retenue de présence, des signes nombreux et forts échangés d’une rive à l’autre, et la traversée toujours nécessairement différée. Mais la différance mémoire entre nous de ce mot de Jacques et de Jacques lui-même (2) , la différance (3) de l’un à l’autre diffère peu, en fin de compte, de la différance à soi-même.
Aujourd’hui la différance infinie est finie ; la césure s’éternise, la syncope reste ouverte. Ce n’est pas sans beauté, malgré tout, tu le sais : c’est même ton savoir le plus intime.
(1) Nom dont Hölderlin, devenu fou, signait ses derniers poèmes, ndlr.
(2) Le philosophe Jacques Derrida, avec lequel les deux hommes formaient un trio, ndlr.
(3) Mot forgé par Derrida : le processus par lequel diffèrent les concepts.

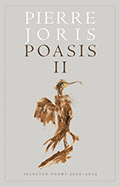 Poasis II: Selected Poems 2000-2024
Poasis II: Selected Poems 2000-2024 “Todesguge/Deathfugue”
“Todesguge/Deathfugue” “Interglacial Narrows (Poems 1915-2021)”
“Interglacial Narrows (Poems 1915-2021)” “Always the Many, Never the One: Conversations In-between, with Florent Toniello”
“Always the Many, Never the One: Conversations In-between, with Florent Toniello”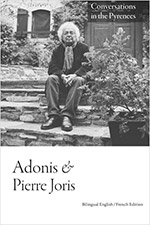 “Conversations in the Pyrenees”
“Conversations in the Pyrenees” “A Voice Full of Cities: The Collected Essays of Robert Kelly.” Edited by Pierre Joris & Peter Cockelbergh
“A Voice Full of Cities: The Collected Essays of Robert Kelly.” Edited by Pierre Joris & Peter Cockelbergh “An American Suite” (Poems) —Inpatient Press
“An American Suite” (Poems) —Inpatient Press “Arabia (not so) Deserta” : Essays on Maghrebi & Mashreqi Writing & Culture
“Arabia (not so) Deserta” : Essays on Maghrebi & Mashreqi Writing & Culture “Barzakh” (Poems 2000-2012)
“Barzakh” (Poems 2000-2012) “Fox-trails, -tales & -trots”
“Fox-trails, -tales & -trots”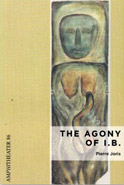 “The Agony of I.B.” — A play. Editions PHI & TNL 2016
“The Agony of I.B.” — A play. Editions PHI & TNL 2016 “The Book of U / Le livre des cormorans”
“The Book of U / Le livre des cormorans” “Memory Rose Into Threshold Speech: The Collected Earlier Poetry of Paul Celan”
“Memory Rose Into Threshold Speech: The Collected Earlier Poetry of Paul Celan” “Paul Celan, Microliths They Are, Little Stones”
“Paul Celan, Microliths They Are, Little Stones” “Paul Celan: Breathturn into Timestead-The Collected Later Poetry.” Translated & with commentary by Pierre Joris. Farrar, Straus & Giroux
“Paul Celan: Breathturn into Timestead-The Collected Later Poetry.” Translated & with commentary by Pierre Joris. Farrar, Straus & Giroux
Pierre,
You might enjoy reading Philippe Beck’s hommage to PL-L on Sitaudis, called “Modalites” I believe: http://www.sitaudis.com.
Amicalement,
Alex